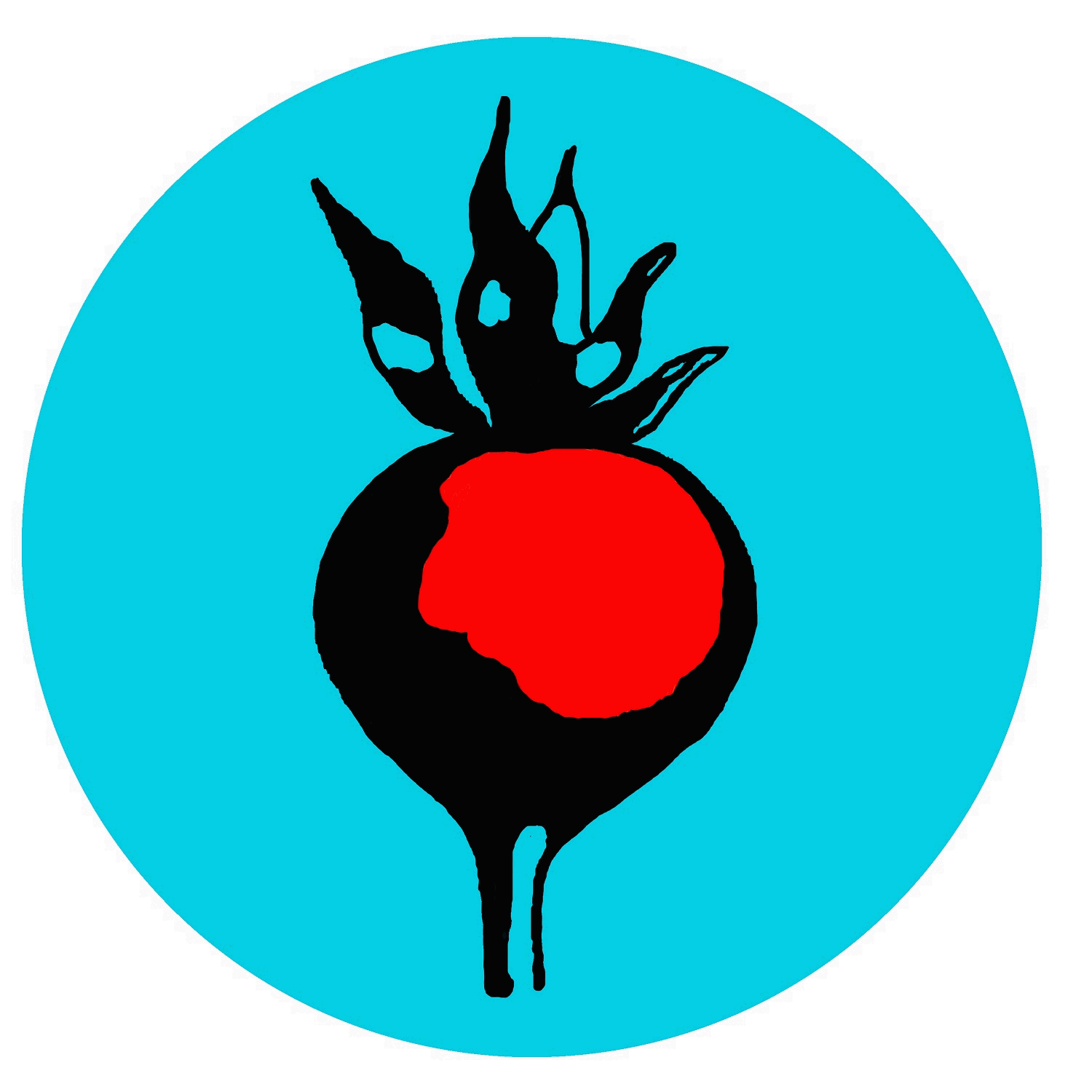|
Le poil à gratter…
|
|
Vogel Apacheta |
|
|
|
Tout aventurier est né d’un mythomane. Qui est Vogel Apacheta, cette plasticienne qui produisit des œuvres sous les noms de Johanna Pacheco Surriable, son identité pour l’état civil, JoⒶhanna, un pseudonyme brièvement utilisé, dont la graphie évoque une allégeance anarchiste, ou celui qu’elle utilise aujourd’hui ? Ce que nous savons, c’est qu’un apacheta, issu du mot apachita des langues quechua et aymara[2], signifie lieu de repos, souvent matérialisé par un monticule de pierres entassées de forme conique. Ces balises ont été créées, plus particulièrement dans les passages périlleux des chemins de la Cordillère des Andes[3], par les populations indigènes comme offrande à Pachamama, la déesse inca de la fertilité, ou à d’autres déités locales. Il désigne aussi, par extension, les points culminants des chaînes andines. Quant à Vogel, c’est le mot allemand qui signifie oiseau mais peut aussi, dans certaines expressions, désigner familièrement un personnage considéré comme douteux, un voyou (ein schräger Vogel, un drôle d’oiseau) ou un gauchiste (ein linker Vogel)… Vogel Apacheta est effectivement née dans les Andes, à La Paz, en Bolivie, donc à 3 600 mètres d’altitude. Sa peinture, vivement colorée, joyeuse et animée doit évidemment à ses origines latino-américaines et à l’atmosphère quelque peu raréfiée des hauteurs andines. On y retrouve le chaud et le froid des couleurs de son enfance, entre soleil et glaciers, mais revus à l’aune d’une expression qui s’infléchit lors de sa rencontre avec les grands peintres occidentaux, découverts, autrement que par les reproductions dans des livres, assez tardivement lors de sa formation, conclue au Mans et à Berlin. C’est lors de ce séjour à Berlin qu’elle a probablement décidé de devenir aussi Vogel… dans les deux sens du mot… L’art de Vogel Apacheta combine donc un ancrage dans les traditions et influences latino-américaines, notamment dans les mythes des achachachilas, ces ancêtres qui protègent les Aymaras, originaires de la région du lac Titicaca au croisement de la Bolivie, du Pérou, de l’Argentine et du Chili, avec des pulsions libertaires, voire anarchisantes, développées au contact de l’Europe occidentale. Ce drôle d’oiseau ne serait-il pas le condor des Andes (vultur gryphus), le plus grand rapace du monde, vivant sur l’altiplano bolivien, région de naissance de notre artiste, volatile pacifique, malgré son aspect redoutable, dont, particularité rare dans la famille des vautours, la femelle est plus petite que le mâle ? Tout porte à le croire… L’artiste, qui aimait, dans son adolescence, se définir comme une mythomane, invente et raconte des histoires, mêlant réalité et imagination, dans lesquelles elle est partie prenante, voire le personnage principal. C’est donc en aventurière qu’il faut considérer Vogel Apacheta si l’on en croit les mots figurant en exergue de ce texte, mis, par Malraux, dans la bouche d’un de ses héros. Tout procès en narcissisme peut donc être évacué. Bien au contraire, nous sommes confrontés aux travaux d’une plasticienne qui expérimente, s’aventure, sans trop se soucier de ce que les spectateurs de ses œuvres en penseront… Une artiste qui cherche, se cherche et nous entraîne inexorablement dans le tourbillon de sa démarche… Il en résulte de grandes toiles libres, peintes au sol de son atelier, qui, comme chez Joan Mitchell, n’entrent dans aucune des classifications préétablies par les manuels – toujours simplistes – d’histoire de l’art. Elle n’est ni abstraite ni figurative… Du moins en première approche… La peinture de Vogel Apacheta est narrative, sans aucun doute, mais relate des histoires dont elle seule connaît la trame et qu’elle ne nous livre que par bribes, par des indices souvent indiscernables, laissant le regardeur construire ses propres scénarios, devenir mythomane à son tour… Malraux, toujours lui, n’a-t-il pas écrit : « Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions et aux mythomanies épiques[4]. » L’exercice peut ainsi, selon les propos de l’artiste, se muer en outil de découverte du monde, en épopée initiatique, avec pour objectif « d’éprouver le réel de nos sociétés, de réfléchir à son avenir ou à sa non-existence[5] ». Et d’ajouter : « Je suis curieuse de voir habiter l’individu dans son espace, son environnement avec ses perturbations du quotidien et ses mystères. Je pense qu’il y a une agitation poétique qui se crée entre les surfaces réelles et invisibles, ces espaces que l’on traverse sans s’en apercevoir, nous transformant et nous remplissant d’une mémoire[6]. » Cependant, cette forme de mémoire n’atténue pas la couleur, contrairement à ce que le poète José Carlos Llop constate au sujet du processus mémoriel : « La mémoire, comme le rêve, dilue les couleurs. La mémoire est comme une photographie exposée au soleil[7]. » À l’opposé, chez Vogel Apacheta, les couleurs sont exacerbées, saturées. Elles magnifient la lumière, faisant écho au point de vue de Jean Guitton : « La couleur est la gloire de la lumière[8]. » Ce qui se dilue, se dissout, chez Vogel Apacheta, c’est la forme. On devine ses sources picturales dans la végétation et les paysages de son pays natal ou d’ailleurs. Elles resurgissent sous forme de fragments qui auraient été déstructurés, déconstruits[9], par un dispositif semblable à celui d’un kaléidoscope, avec des effets de réflexions en miroir, des lignes de clivages, des pliages, des fausses symétries, des collages et des superpositions… Nous sommes ici dans un espace de pleine liberté, dans lequel la question de la figuration ou de la non-figuration ne se pose pas. Les peintures qui en résultent entrent ainsi en résonance avec un autre propos de Malraux qui écrivait : « Le conflit entre figuratifs et non-figuratifs n’a d’importance que par son enjeu, qui fut la liberté du peintre (Pollock commence à Olympia…), fût-elle la liberté de trouver de nouvelles figurations. On ne l’abandonnera pas de sitôt[10]. » Les formes, outre des réminiscences végétales, peuvent traduire graphiquement des itinéraires réels ou fantasmés, des éléments architecturaux, des objets de l’environnement quotidien, des petits riens sans importance empruntés à la vie de tous les jours, abordés de façon factuelle ou avec un brin de révolte ou de folie. La couleur, toujours très présente, explose et projette ces lignes et surfaces dans un espace mis en abyme, comme Yves Bonnefoy le déclare : « La couleur n’est-elle pas là pour jeter d’un coup toute sa profondeur dans le discours du tableau[11] ? » Souvenirs de son enfance andine ou notes relevées dans l’espace urbain de l’Europe occidentale, mélange des deux ou effets de synesthésies, comme nous le verrons, tout est bon pour faire ressentir le chaud et le froid, la sous-jacence d’un geste incisif qui réveille, interpelle ou fait rêver le spectateur sans, pour autant, imposer une lecture ou une interprétation univoque. Interrogation d’un inconnu, celui de l’artiste et celui du regardeur… L’artiste, dans son enfance au pied des cimes, ne se posait-elle pas la question : qu’y a-t-il derrière la montagne ? Au regardeur de ses peintures de répondre… Plus récemment, Vogel Apacheta s’est mise à enregistrer des sons lors de ses trajets quotidiens ou de ses déplacements occasionnels. Elle capture des bruits dans des espaces acoustiquement saturés, superpositions ou maillages de bribes de conversations intenses ou anodines, de fragments d’annonces dans les gares ou dans les aéroports, de vrombissements de véhicules motorisés, d’éclats sonores de fêtes foraines… Revenue en atelier, elle utilise ces enregistrements comme point de départ pour ses peintures ou ses dessins, voire pour des projets d’écriture ou de vidéos. Cette démarche synesthésique s’inscrit dans la ligne des vers de Baudelaire : Et Vogel Apacheta n’a pas fini de nous surprendre… Louis Doucet, janvier 2024
[1] In La Voix royale, 1930.
|
|
Quelques acquisitions récentes |
|
|
Annonces |
|||||
|
du 14 septembre au 21 décembre 2024
Évasion
|
|||||
|
|
Cynorrhodon - FALDAC recommande | ||||
|
Lidia Lelong du 1er au 19 octobre 2024 Galerie du Haut-Pavé – 13 quai de Montebello – 75005 PARIS |
|||||
|
Annoncez la couleur ! avec Élodie Boutry, Claude Briand-Picard, Gabriele Chiari, Philippe Desloubières,Guillaume Goutal, Joël Hubaut, Dominique Jézéquel, Maëlle Labussière, Quentin Marais, Élissa Marchal et Antoine Perrot du 6 juillet au 31 août 2024 Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC |
|||||
|
Côte À Côte – Beira A Beira Peter Kramer – Manuel Facal – Elena Matamoro – Ruth Vidal – Tuset – Vari Caramés – Eva Antelo – Fred Langford Edwards – Pedro Tasende – Manolo Eirín du 20 juillet au 18 août 2024 Atelier du Hézo – 6 impasse Bihan – ZA de Lann Vrihan – 56450 LE HÉZO |
|||||
|
L’Art dans les chapelles Amandine Arcelli, Kees Barten, Bernard Calet, Frédéric Houvert, Karen Irmer, Konrad Loder, Laurent Mareschal, Ariane Michel, Ariane Monod, Josée Pitteloud, Sylvain Roche, Annie-Paule Thorel, Anthony Vérot du 5 juillet au 31 août 2024 Pays de Pontivy |
|||||
|
Kacha Legrand – Alain Chauvet du 27 juillet au 15 septembre 2024 Abbaye de Coat Malouen – 22480 KERPERT |
|||||
|
macparis Automne 2024 du 12 au 17 novembre 2024 Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS |
|||||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2024
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre
–
Ne plus recevoir la lettre