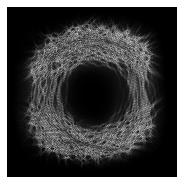|
macparis automne 2019
du 12 au 17 novembre 2019
74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS
(notices rédigées par Louis Doucet)
|
|
36 ans…
Concha Benedito nous a quittés le 13 avril dernier, dans sa 91ème année, au terme d’une très longue maladie. En 1983, elle fondait mac2000, association sans but lucratif, s’inspirant alors du Salon de la Jeune peinture, devenu depuis Jeune création, dont elle faisait partie du bureau et ne partageait pas les orientations d’alors. Pendant dix ans, la manifestation occupa les galeries du Grand-Palais, puis, suite aux travaux de rénovation du monument, s’est mise en mode nomade : sept ans à l’espace Eiffel-Branly, sur les lieux de ce qui deviendra le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, trois ans dans les locaux de l’ancienne gare d’Auteuil, treize ans à l’Espace Champerret, et, depuis 2016, au Bastille Design Center, boulevard Richard-Lenoir, magnifique architecture du type Baltard.
Dans les années Grand-Palais, la manifestation était scindée en deux parties : deux semaines consacrées à la peinture et deux à la sculpture. Ensuite, elle s’est adaptée à la géométrie des lieux, aux coûts de location des espaces, en constante augmentation, et à ses ressources budgétaires, de plus en plus réduites. Dans les années Champerret, elle accueillait jusqu’à 130 plasticiens pendant quatre ou cinq jours. Depuis 2005, Hervé Bourdin, bientôt rejoint par Annick et Louis Doucet, assurent bénévolement la gestion de ce qui est devenu macparis l’association conservant le nom de mac2000.
À travers ces multiples évolutions pour s’adapter à un environnement changeant, quelques constantes, telles que Concha Benedito les avait voulues, ont perduré : une sélection sur dossier et visite d’atelier, la présentation d’un nombre significatif d’œuvres de chacun des artistes choisis, l’absence de commissions prises sur les ventes… D’autres ont évolué : il n’est plus demandé de contribution financière aux exposants, ce qui a mécaniquement entraîné leur rajeunissement ; la manifestation se tient deux fois par an, au printemps et à l’automne ; le nombre des exposants a diminué et le nombre de candidatures doublé, ce qui résulte en un plus grand niveau d’excellence… De plus, signe des temps qui nous réjouit, les femmes constituent désormais la majorité de la sélection et la moyenne d’âge des exposants a chuté.
En 2019, macparis, c’est près de 2 000 dossiers reçus pour un peu moins de 50 exposants sélectionnés, plus de 200 visites d’atelier, près de 12 000 kilomètres parcourus pour ces visites, plus de 100 000 visiteurs uniques par an sur le site Internet macparis.org, plus de 40 000 adresses de personnes intéressées dans nos fichiers régulièrement mis à jour, plus de 10 000 visiteurs par an au Bastille Design Center, dont de nombreux professionnels du monde de l’art, des retombées significatives pour un grand nombre des plasticiens sélectionnés…
mac2000/macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon – FALDAC, la programmation des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus de 8 000 visiteurs par an et un important programme de médiation vers les publics locaux…
Grâce au soutien du Ministère de la Culture, de l’Adagp et de quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, l’aventure continue…
Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet
commissaires de la manifestation
|
 | Thierry Bedoux, parti de la peinture figurative, a progressivement évolué vers une forme d’abstraction nourrie par la fréquentation des arts premiers d’Afrique noire et par la lecture d’ouvrages ethnographiques. Dans un processus de retour aux sources, l’image prend alors, chez lui, une dimension magique et rituelle, visant à invoquer des présences invisibles plutôt que figurer des réalités tangibles ou visibles.
Son activité au sein d’une compagnie de spectacle l’a conduit à sortir du confort de son atelier pour se frotter à des sites, à des thématiques et à des contextes variés dont il n’avait pas le choix. En abandonnant le cadre habituellement dévolu à la monstration des œuvres plastiques, il en est résulté des installations qui intègrent les dimensions publiques, sociales, humaines, économiques, culturelles et politiques de notre monde. Pour Thierry Bedoux, tout acte de création quel qu’il soit est d’essence politique et spirituelle : créer quelque chose, c’est modifier l’ordre du monde et c’est aussi imprimer de l’esprit dans de la matière.
Son installation Les lucioles, parfois sous-titrée Les mémoires invisibles, part de matériaux banals, des bocaux suspendus transformés en lanternes, chacun incluant une image, du type de celles que l’on trouvait autrefois dans les albums de photographies de famille. Il s’agit donc ici, non pas de rendre visibles des souvenirs ou des événements passés, mais de susciter, chez le spectateur, un effort de recherche sur sa mémoire, sur sa propre histoire, réelle ou fantasmée. |
 | Les sculptures linéaires, en acier peint, de Frédéric Bertuglia se présentent comme de grands dessins dans l’espace, comme des épures d’architecture qui auraient acquis une troisième dimension. Elles sont posées, à la limite du déséquilibre, et ne délimitent pas des surfaces, mais des volumes, des fragments de vide qui prennent, par leur effet, une matérialité presque tangible. En tournant autour de l’œuvre, ces polyèdres, qu’on ne peut qualifier de virtuels, découpés dans le néant, changent de structure et s’animent lentement, donnant accès à la quatrième dimension, celle du temps.
Chez Frédéric Bertuglia, le vide se fait ainsi masse sculpturale mouvante, parfois fuyante, parfois rétractée, selon l’angle de vision du regardeur. L’interprétation est laissée libre. Certains y verront des bâtis ou des charpentes, d’autres des portes ou des forêts, des divinités totémiques tutélaires ou des personnages stylisés, des groupes familiaux ou des antagonismes belliqueux, des humanoïdes ou des gigantesques arachnides…
Quelle qu’en soit la lecture, l’artiste déclare vouloir amener le spectateur à se projeter à travers l’œuvre vers un questionnement et une réflexion sur la nature du temps, tant par l’approche de la nature suspensive des mouvements arrêtés et déséquilibrés, que des interprétations liées aux caractères humanoïdes des pièces et des relations qui se jouent entre elles. |
 | Lucie Bitunjac s’intéresse à l’architecture, avec une prédilection pour l’Italie pré-Renaissante, le mythe de Babel et les projets utopistes ou idéalistes des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans ces modèles, ce sont les fortifications, les frontières et les portes qui retiennent plus particulièrement son attention. Elle en livre sa relecture, dégagée de règles de la perspective traditionnelle, dans des dessins, des peintures et des céramiques. Pour autant, ses productions n’ont que peu de rapport avec les Architectones de Malevitch ou avec les compositions des suprématistes. C’est que, contrairement à ces derniers, Lucie Bitunjac n’oublie pas la dimension subjective de toute création plastique et entend donner un véritable rôle à l’humain et, en particulier, au regardeur. Elle déclare, en effet : je développe un travail qui questionne les champs en lien avec l’anthropologie, la dépendance des dynamiques des forces sociales ou leurs faiblesses. Je crée des objets qui sont picturaux ou volumétriques, qui peuvent proposer une occupation non utilisante de l’espace sans être pour autant inutiles.
Il s’agit donc d’espaces mentaux, qui évoquent, ici les souvenirs de voyages en Italie, et notamment à Sienne, là les espaces paradoxaux d’un Piranèse ou, dans le domaine littéraire, de Raymond Roussel, ailleurs la Cité Céleste de saint Augustin et sa traduction musicale colorée par Olivier Messiaen, ailleurs encore les labyrinthes crétois ou les productions d’un Ellsworth Kelly ou des Californiens du hard-edge.
Au regardeur de construire son interprétation personnelle sur la base de sa propre histoire… |
 | Les travaux d’Anne Bothuon et de Claire Espanel, déjà montrés séparément lors de sessions précédentes de macparis, n’ont que très peu de points communs. La première propose des sculptures en toile à taille humaine, dans un style expressionniste, la seconde dessine, sur des supports diaphanes, des paysages oniriques souvent inquiétants.
Ce sont justement ces différences qui les ont incitées à proposer un ensemble d’œuvres, formant installation, sur le thème de l’altérité. Elles déclarent : alors qu’aujourd’hui, le selfisme, narcissisme de masse, est devenu une nouvelle religion, nous avons choisi de croiser nos chemins, de travailler avec l’autre et sur l’autre. Nous allons dialoguer, établir une relation d’enrichissement réciproque, basée sur le partage et la compréhension mutuelle.
Elles ont travaillé, ensemble et séparément, sous forme de laboratoire. Elles nous présentent le fruit de leurs recherches, sous forme de croquis, de dessins achevés et de sculptures. On découvrira des travaux à quatre mains, des œuvres en miroir, chacune s’inspirant du travail de l’autre, et des pièces qui mettent le spectateur en situation et l’obligent à oublier provisoirement son ego et à s’investir.
Ce que font ces deux plasticiennes, ce n’est pas seulement de s’interroger et d’interroger le regardeur sur l’autre, mais, plus profondément, de répondre à l’interrogation d’une rare actualité : comment déplacer l’altérité ? |
 | Les photographies de Delphine Cencig dérangent. Ce n’est pas sa technique, irréprochable, ni ses compositions, souvent inspirées par la peinture classique, mais son univers plastique qui déstabilise le spectateur. Il est pourtant d’une étrange beauté, mais cette beauté relève plus de celle adulée par les surréalistes, admirateurs de Lautréamont et de sa rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie, que des canons habituels. On peut aussi y voir des scènes qui pourraient appartenir au monde de Jérôme Bosch ou à celui de la littérature fantastique de Poe ou de Kafka.
Les personnages qui y évoluent ont un statut intermédiaire entre humain et elfe, entre poupée désarticulée et humanité bien incarnée, entre littérature pour adultes et livres d’enfants, entre adoration et sacrilège… L’atmosphère est onirique mais peut virer au cauchemar, comme s’il s’agissait de jeux anodins mais probablement dangereux, d’un perpétuel état d’instabilité entre vie et mort. La sexualité et la sensualité y sont à fleur de peau, mais jamais explicitées. Une forme de féminisme y est exprimée, mais il semble en permanence refoulé par des images qui peuvent faire de la femme une marionnette ou une criminelle, la confiner sous une cloche de verre…
Finalement, dans cet univers en suspension permanente entre des écueils invisibles mais fortement suggérés, ce que Delphine Cencig veut exprimer n’est que le tragique de la condition humaine et, plus spécifiquement, de la féminité… |
 | Stéphane Dauthuille peint à la gouache et à la cire sur des feuilles de papier qu’il maroufle ensuite sur toile. De cette matière picturale résultent les couleurs douces et sensuelles, mais cependant affirmées, qui baignent ses compositions. Ses thèmes de prédilection sont dans le même registre, combinant figures humaines et objets placés dans des situations ambiguës, dans un alliage d’empathie et de douceur, d’élégance et d’étrangeté, d’impudeur et de candeur… Chimères et mélanges, selon ses propres mots.
Dans ses séries les plus récentes, il met en scène des cabanes de toutes dimensions, placées dans des paysages oniriques ou isolées et détourées, résultant parfois de la métamorphose improbable de chaises. Ces dernières évoquent l’innocence des jeux de l’enfance, quand tout devient prétexte pour construire des abris protecteurs, substituts au sein maternel. Il y est question d’indécision entre intérieur et extérieur, de fusion entre maison et paysage, de ressemblances incertaines, de constructions fragiles et instables, de voisinages improbables… Autant de points laissés en suspens, de questions posées mais laissées sans réponse univoque…
Ces compositions racontent évidemment des histoires intimes, mais la clé de lecture n’en est jamais livrée. À chacun de les interpréter à sa façon, d’y projeter ses rêves ou ses fantasmes, d’en faire la base de sa propre réflexion, bien au-delà de ce qui est simplement et presque naïvement donné à voir… |
 | Le matériau de base des sculptures et installations de Léa Ducos est constitué par des chutes de bois, de stratifié ou de laminé provenant d’ateliers de menuiserie. Elle les assemble, les pose au sol ou les adosse à un mur, dans des compositions qui évoquent fragilité et instabilité, comme si le moindre mouvement inconsidéré du spectateur risquait de tout compromettre. Il en résulte une tension, tant dans la structure des œuvres elles-mêmes que chez le regardeur, invité à déambuler entre les pièces, qui craint, à tout instant, de mettre en péril le précaire équilibre de ces frêles châteaux de cartes.
Et pourtant, rien n’est laissé au hasard ni à l’improvisation. Tout est pesé, mesuré, mûrement réfléchi… Si l’aspect ludique – et parfois dérisoire – est souvent présent dans ses œuvres, Léa Ducos n’a pas oublié les leçons de l’histoire de la statuaire, depuis les idoles pré-cycladiques jusqu’aux créations contemporaines les plus récentes, en passant par les constructivistes russes et les arts premiers. Elle aime à faire un parallèle entre son travail et celui de l’écrivain, considérant, dans la descendance d’un Mallarmé, ses productions comme une forme d’écriture poétique dans l’espace d’exposition. Son objectif avoué est de provoquer un éveil créatif, de stimuler le mouvement, tout en s’inspirant d’une multitude d’autres univers : la musique, la poésie, les histoires et jeux d’enfants, les règles de base de la physique… À cette fin, elle cultive les ambiguïtés, les lectures multiples, les doubles sens, les calembours visuels, les exercices combinatoires… le tout avec une malice dont le spectateur est invité à partager le plaisir. |
 | Au premier abord, les toiles de Sylvie Herzog ont quelque chose de séduisant, de drôle. On y voit des figurines de héros bien connus ou des objets communs, tels cet épouvantail à moineaux ou ce godillot isolé, nappés d’un coulis noir, rouge ou orange – réglisse, sauce tomate ou glacis de pâtisserie – qui les laisse souvent indifférents. Il y a, dans ces images, une forme de sensualité gourmande, de plaisir presque sadique de salir ces idoles plus ou moins consentantes, à tout le moins incapables de réagir… Une forme de régression vers le stade anal…
Il n’en est rien, cependant. Très vite le regardeur est poussé à lire ces toiles autrement. Le noir ne serait-il pas le goudron d’une immense marée noire, le rouge le sang de victimes humaines ou animales, l’orange la coulée d’un pesticide ou d’un défoliant ? D’ailleurs, la série s’intitule Jeux de guerre. Le doute n’est plus permis… Les peintures de Sylvie Herzog sont donc militantes. Elles dénoncent le triste monde que notre lâcheté ou notre indifférence est en train de léguer à nos enfants. Il y est donc question de pollution, de toxicité, de censure, de lobbies, de sang versé…
L’artiste pose clairement la question : ces héros enlisés dans la peinture seraient susceptibles de nous délivrer de ce monde ? La réponse est sans appel : non, ils sont prisonniers de notre société… C’est donc à nous, et non pas à des tiers, aussi célèbres ou connus soient-ils, de prendre en charge le problème et de lui apporter son indispensable solution. Une question de vie ou de mort… |
 | Marion Jannot dessine. On ne peut oublier sa série Dissolutions, réalisée sur la thématique du séchoir à linge, déconstruit et reconstruit, comme autant de variations musicales sur un thème initial, quotidien et familier, mais qui, par le seul recours à des traits incisifs s’entrecroisant, domestiquent, animent et peuplent la béance de la feuille blanche. Le dessin donne une forme au vide, aurait pu dire Braque. Plus tard, dans la série Claustrations, elle met en scène des clenches de porte, isolées ou superposées dans des positions successives, comme dans un chrono-photogramme ou à la manière dont certains bédéistes figurent le mouvement dans leurs vignettes. Le dessin prend ici une nouvelle dimension. La question demeure de savoir à quel espace donnent accès les portes invisibles portant ces clenches si présentes. Probablement celui d’un vide qui ne peut exister.
Plus récemment, Marion Jannot s’est intéressée à la végétation, dans la descendance de Matisse, mais aussi de certaines feuilles peu connues d’Ellworth Kelly. La notion de prolifération y est latente. On pense à un réseau de fractales dont le développement est régi par une nécessité au-delà du vouloir et du contrôle de l’artiste, laquelle déclarait déjà, dès sa sortie de l’École des Beaux-Arts : Les formes ne se constituent pas par injonction, mais plutôt par une sorte d’analogie sensible. La composition n’est pas pensée a priori, mais s’effectue dans l’intuition des rapports des formes avec les bords et des formes entre elles. Ces rapports créent un jeu, une distance, qui libèrent un espace o ù les formes se répondent, s’assemblent, se désagrègent ou s’épuisent. |
 | La vidéo-sculpture Le Gardien de Loïc Jugue apparaît comme une sorte de cyclope, une structure métallique évoquant les araignées de Louise Bourgeois, à laquelle elle est dédiée, dotée de trois moniteurs vidéo présentant trois fragments d’un même visage : un œil, le nez et la bouche. Il s’agit d’une relecture contemporaine de la leçon du cubisme historique, visant à déstructurer l’espace et à le reconstruire en s’affranchissant des canons traditionnels de la perspective et de la vision réaliste.
Dans cette œuvre qui accueille le visiteur à l’entrée du Bastille Design Center, Loïc Jugue s’interroge – et nous interroge – sur le rôle de la surveillance généralisée de nos faits et gestes quotidiens dans l’espace public. Nous avons du mal à comprendre la signification de ces dispositifs, ignorons s’ils sont en place pour nous protéger, pour nous surveiller ou, peut-être, pour nous détruire... L’artiste s’exprime : dans notre société o ù les gardiens sont de plus en plus nombreux… a priori pour nous protéger… mais surtout pour nous contrôler… il me semblait important de m’en inspirer, de les montrer… d’une façon artistique, dénués de leur fonction. Ces vidéo-sculptures (ce ne sont pas des robots) feront à leur manière leur travail. Elles seront à l’entrée des expositions, des musées ou des centres commerciaux… aéroports ou autre… pour surveiller… vous surveiller… pour votre bien… Mais est-ce vraiment le cas ? Le tout-sécuritaire est-il la meilleure réponse pour avoir le meilleur des mondes… Avons-nous envie de ce monde… si nous sommes privés de liberté ?
À nous de nous faire une idée… Sachant que, à macparis, le rôle de ce gardien n’est que de nous interpeller… |
 | Edwige K n’est venue que tardivement à la photographie. Elle a commencé par collecter des images de son environnement immédiat, de ces petits riens qui meublent la quotidienneté. Ses premières réflexions l’ont portée à s’intéresser au mouvement et au flou qu’il laisse sur le support photographique : visions transitoires, passages fugaces, présences humaines éphémères, dans des environnements stables, solides et pérennes, presque immuables… Ces clichés se posaient alors en métaphores du processus mémoriel, en témoignage de la labilité du temps.
Plus récemment, notamment sans sa série Jaune pivoine, Edwige K s’est tournée vers des sujets moins mouvants, dont la netteté célèbre la stabilité des choses et bannit toute notion de déplacement, tout mouvement physique. Ce sont des (auto)portraits de dos, dans lesquels la chevelure noire tient toute la place, agrémentée de fleurs blanches ou reposant sur une gerbe de pivoines jaunes. Dans ces photographies, l’artiste effectue une sorte de descente introspective à l’intérieur d’elle-même, mais nous laisse toute liberté d’une interprétation autre. Ses images se présentent comme de modernes vanités, comme des memento mori, et, finalement, traitent de la même question que ses premières productions : la fragilité de la vie, le caractère inexorable du passage du temps, la vulnérabilité de la condition humaine… |
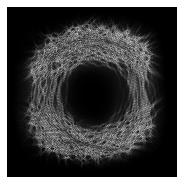 | Le système en œuvre dans l’ensemble de la pratique artistique de Mael Le Golvan est basé sur la révélation d’oppositions, sur le fait de contredire le réel. Il se place dans une posture de libre lecture / réécriture des éléments et signes de notre réalité, qu’elle soit naturelle, technique, sociale ou culturelle, sans distinction. Mais sa réécriture, comme pour mieux activer la pensée, va toujours à contre-sens. Les contradictions au sein de ses œuvres ont pour effet de produire des dynamiques créatrices de pensées et de formes esthétisées. C’est, par exemple, le cas de son fréquent recours à la technique de la nuit américaine qui transforme le jour en nuit.
Les clichés argentiques de sa série Photogrammes sonores sont produits par la diffraction de la lumière à travers une fine pellicule d’eau mise en vibration par des ondes sonores. Ce dispositif, à la fois sonore et photographique, a pour effet de structurer la lumière par le mélange de l’eau et du son. Le phénomène de diffraction, en détournant la lumière, vient créer une écriture graphique composée de zones d’ombres en blanc et de zones lumineuses en noir. Ces images sont générées par une eau traversée par le son, qui la fait onduler de manière systématique, et par la lumière, diffractée dans de multiples directions. Bien que la technique du photogramme argentique et la génération d’ondes sonores soient maîtrisées, leur hybridation est propice à révéler de nouvelles formes issues d’événements fortuits tels que d’infimes variations du volume d’eau. |
 | Jacques Maitrot a une formation d’ingénieur mécanicien, mais a aussi pratiqué de multiples autres activités. En tant que plasticien, il développe des séries, plus ou moins étendues, s’appuyant sur deux thématiques principales : les objets techniques en relation à l’homme, dans la lignée de la pensée du philosophe Gilbert Simondon, et la route dans ses relations à notre espace, dans l’esprit des ouvrages J. G. Ballard, écrivain de science-fiction et d’anticipation sociale. Ses médiums de prédilection sont la vidéo, la photographie et l’installation, ce qui n’exclut pas des incursions dans le domaine de l’écriture et de l’architecture utopiste, tel son projet de Musée du rien contemporain, ou ses essais récents en cyanotypie.
Parmi ses vidéos, on retiendra Passage #1, immersive, montrant un pont de chemin de fer, entrée mouvante d’un parcours vers l’incertain, une série montant la lente destruction de semelles de fers à repasser ou de sèche-cheveux électriques soumis à une surtension…
Pour ce qui est de la photographie, on est fasciné par ses clichés figurant, sur fond noir, de vieux condensateurs variables autrefois utilisés dans les récepteurs radio, détourés, dé-fonctionnalisés, parfois humanisés… Ces mêmes objets techniques entrent aussi dans la composition de paysages industriels improbables et parfois menaçants… On s’attardera aussi sur ses relectures du Nu descendant l’escalier de Duchamp ou d’Ema (Nu sur un escalier) de Richter. |
 | Nomah exerce une carrière médicale tout en se consacrant à la peinture depuis près de dix ans. Sa technique, complexe et méticuleuse, mêle l’acrylique, l’encre et des glacis à l’huile, dans une recherche de perfection formelle qui évoque le travail en atelier à l’époque des guildes de peintres. Son univers est fortement inspiré par les planches d’anatomies des livres de médecine et par ses observations in vivo dans le cadre de sa pratique chirurgicale. Ses compositions convoquent expressionnisme et réalisme, le tout mâtiné de surréalisme, dans un imaginaire qui nous invite à un voyage intérieur, à l’intérieur de nos propres entrailles. Elles nous renvoient à notre condition organique, biologique, animale, mais dans une mise en scène qui fait penser aux hallucinations physiologiques des peintures de Dado ou de Ljuba. Rien de terrifiant, cependant, dans ces investigations, mais une forme de jubilation délirante qui nous rappelle nos origines, nous oblige à une forme de modestie tout en forçant l’admiration devant la perfection de notre mécanique humaine.
Plus récemment, Nomah s’est intéressé à la technique de la gravure. On retrouve, dans ses planches, la même obsession de rigueur et de perfection technique que dans ses peintures. Cependant, le recours aux seuls noir et blanc rend ses estampes encore plus mystérieuses et fascinantes. |
 | Après avoir été céramiste, Frédéric Oudrix, pratique aujourd’hui la peinture à la gouache. Il s’exprime, avec une imprécision volontaire et préméditée, au moyen des paumes de ses mains et de ses doigts, sur de grandes feuilles de papier qu’il découpe ensuite et réassemble pour créer des végétations improbables et foisonnantes, dans lesquelles les vides jouent un rôle primordial. L’artiste déclare : Le temps passe. Le peintre s’adapte à l’éventuel ennui qui pourrait avoir raison de ces années de sacerdoce. Pour cela, j’ai délaissé progressivement les pinceaux au profit de la pulpe de mes doigts et de l’imprécision salvatrice de la paume de la main. Maintenant, les ciseaux sont les maîtres d’œuvre. Ils définissent les contours, les collages et les parties que l’on pourrait appeler vides. Les ciseaux conditionnent naturellement l’intégration de la peinture sur le mur et dans l’architecture. Alors, doucement la lumière du jour vient redessiner les contours. Je la remercie.
Suspendues devant des murs, tels des décors de théâtre, ses compositions se comportent comme les frondaisons d’arbres – plus mentaux que réels – dont le bruissement des feuilles s’efface au profit de projections visuelles mouvantes sur les parois qui les accueillent. Le processus de déconstruction d’une végétation idéalisée se matérialise donc, chez lui, par un transfert et une saturation des sens, par une inversion des facultés perceptives. À sa façon, Frédéric Oudrix idéalise le monde végétal tout en dévoyant son essence. |
 | Partant de la peinture, Anne Pons s’en est progressivement affranchie, tout en maintenant la nécessité qu’impose de cette pratique de penser l’espace, la tension entre les masses picturales, l’importance d’une certaine forme de frontalité et la dualité latente entre figure peinte et réalité observée. Ses travaux ont acquis une troisième dimension, déployant une multitude de techniques et de matériaux. Elle privilégie les matières simples et une certaine humilité nourrie dans la lenteur des gestes qui président à ses créations.
Ses Pardessus sont de grandes pièces en feutre de laine, issues de deux petites sculptures en bois tourné réalisées en 2010. Leur forme molle se stabilise quand ils sont fixés au mur, suspendus par un simple clou, évoquant une peau, la dépouille d’un improbable animal, les drapés d’une sculpture de l’époque baroque… Anne Pons, à l’instar de Richard Serra, attache une grande importance aux processus de réalisation de ses œuvres et aux gestes qui les accompagnent, déclinés sous forme de verbes actifs : feutrer, agrandir, réduire, découper, appliquer, juxtaposer, bâtir, coudre…
Certains des outils servant à l’élaboration des Pardessus sont devenus des œuvres à part entière, notamment ses poncifs, dessins perforés servant à reporter des formes. Frottés à la brosse chargée de couleur à l’huile, ils procèdent d’un double geste de couverture et d’effacement et, consciemment ou non, renouent, par des chemins détournés, avec la pratique de la peinture. |
 | Lydie Regnier a relevé le challenge, ô combien périlleux, d’investir les casiers de l’escalier du Bastille Design Center. Elle les meuble de petites pièces en céramique, de ces œuvres dont feu Bernard Point écrivait, en 2013 : […] cette flottaison de sculptures en céramique, ces formes brillamment mais troublement colorées, posées sur l’instabilité de leurs courbes, me confondent en me laissant glisser mentalement sur la planéité de ces surfaces qui les couvrent, tout en les décapitant brutalement.
La pratique de Lydie Regnier ne se limite pas à la céramique. Elle pratique le dessin – deux de ces derniers sont aussi présentés ici –, la photographie, la peinture, la sculpture, l’installation… Elle écrit : Le terrain de mes recherches se définit par la constitution d’un environnement, tendu entre naturel et construit. Elles se développent dans un jeu de gestes confrontés à des matériaux […] Dans cette diversité de formes, je cherche à provoquer une circulation du regard en impliquant physiquement le spectateur.
L’artiste prend un malin plaisir à contester la rigueur de l’espace, à provoquer des déséquilibres qui se résolvent en stabilité, à mettre en péril les situations réputées stables, à confondre les règnes animal et végétal, à brouiller les pistes visuelles, à suggérer le désordre à travers un ordre superficiel, à moins que ce ne soit le contraire… Il est question d’entropie, de l’impossibilité de faire retour en arrière, de reconstruire quelque réalité que ce soit à partir de sa représentation…
Ce que propose Lydie Regnier, sans la moindre prétention ni ostentation, n’est peut-être, après tout, que la base d’une nouvelle éthique du regard… |
 | Jade Ronat-Mallié, dans ses vidéos et ses installations, traite du tourisme de masse : puisque le potentiel exploratoire du monde n’existe hypothétiquement plus, imaginer un monde o ù l’univers touristique se suffit à lui-même devient envisageable. La poésie développée dans mon travail, en lien avec la culture populaire, vient d’un rapport dérangé à ce milieu, car il me fascine autant qu’il m’effraie. L’ensemble de mes travaux devient l’esquisse d’un monde essentiellement artificiel et illusoire dans lequel réalité et fiction dialoguent et se confrontent au travers du potentiel esthétique, narratif et poétique que contient l’image banalisée du tourisme de masse.
La vidéo J’aime le bleu qu’ils ont rajouté pose la question de savoir si le bleu de la mer n’est pas qu’une illusion pour touristes. Et, si tel était le cas, quelle différence cela ferait ? Ici, l’artiste contribue à une forme de théâtre de l’absurde, ouvrant la réflexion sur le rétrécissement de l’espace, la poésie en butte à la triviale réalité, le monde en tant que spectacle… Guy Debord n’est pas loin…
Dans En huis clos, Jade Ronat-Mallié reconstitue un paysage, qui n’existe plus que sous forme de bribes dans le souvenir de certains. À cet effet, elle juxtapose six cartes postales touristiques illustrées, en noir et blanc. Le lent défilement de l’image prend le contrepied de la vision du touriste qui consomme du paysage et ne prend plus le temps de l’explorer. L’artiste le fait en lieu et place du voyageur pressé, même s’il ne s’agit que de banalités, plus riches en poésie que la futilité d’un regard rapidement et négligemment jeté. |
 | La peinture de Julia Scalbert nous semble d’une flagrante évidence, d’une candeur patente, presque désarmante. Cette évidence, cette candeur sont, cependant, bien trompeuses car l’artiste n’a pas choisi le chemin de la facilité pour arriver à ses fins. Telle une équilibriste en perpétuel risque de chute mortelle, elle cultive une attirance, une sorte de tropisme pour les situations d’instabilité. D’instabilités, devrait-on dire, parce qu’elles sont multiples. Ni abstraites ni figuratives, ses représentations suscitent – successivement ou simultanément – une multitude de perceptions dont la certitude s’effondre dès que l’on croit en avoir cerné une. Les lectures se superposent ou s’enchaînent mais s’annihilent avant même que l’on ait pu pleinement les concevoir. Chez Julia Scalbert, la forme représentée peut se laisser reconnaître mais perd de son habituelle évidence au profit d’une réflexion sur la matérialité et l’organisation structurelle de la toile.
Pour autant ces objets insaisissables et non identifiables n’ont rien d’insignifiant. Ils ont une présence forte et dérangeante, déstabilisante. On y décèle une sensualité exacerbée, un véritable plaisir de peindre, un corps-à-corps du créateur avec la matière pour tenter de donner forme à ce qui est d’essence fuyante, de rendre visible ce qui, par nature, ne peut pas être visualisé, de dire l’indicible, de peindre l’impeignable. Prégnance de l’invisible, de l’inconcevable, pourrait-on dire si l’on voulait risquer cet oxymore. Il s’agit, en effet, plus de signifier – dans le sens saussurien de ce terme – que de montrer, plus de suggérer que d’affirmer ou expliciter. |
 | Les grands dessins sur papier d’Arnaud Schmeltz sont denses, peuplés de plusieurs couches superposées de personnages, d’animaux, de membres épars, d’éléments architecturaux… dans un esprit qui évoque la liberté gestuelle de certaines productions primitivistes ou les peintures pariétales de nos très lointains ancêtres. Le trait y est souvent virtuose, simple et allusif, les détails fouillés, malgré une première impression, vite démentie, de laisser-aller.
Plusieurs strates d’histoires semblent s’être empilées sur la surface, comme dans un palimpseste dont les couches inférieures auraient été mal effacées. On peut aussi penser à des cadavres exquis surréalistes dont les interventions successives ne seraient pas séquentielles mais empilées. Il en résulte une évocation de mythologies réelles – tel ce Minotaure – ou fictives, dont le fil d’Ariane reste à dérouler…
De la saturation de la surface du subjectile surgit une explosion d’images et de sens qui entraînent le regardeur dans des univers qui peuvent être simultanément hallucinatoires, chimériques ou fantasmagoriques. La hiérarchie traditionnelle entre forme et fond est totalement subvertie, chaque strate servant d’assise aux suivantes, sans qu’il soit possible de discerner ce qui est devant et ce qui est derrière. Tout affleure simultanément dans un exercice de contraction-dilatation de l’espace et du temps qui se traduit par une sorte de vertige, une mise en abîme, laissant le spectateur au bord du gouffre de ses propres fantasmes… |
 | Tout, dans les œuvres récentes de Marine Vu, semble se situer dans l’épaisseur infinitésimale du tégument pictural, dans cet inframince qu’évoquait Duchamp. On y décèle la volonté de confiner l’œuvre dans les limites bidimensionnelles du support, au point même d’abolir la traditionnelle opposition dialectique entre fond et forme, mais aussi de lui donner une troisième dimension. La monochromie blanche impose un silence qui prélude à un (re)commencement. On y pressent l’imminence de la survenance d’un quelque chose, indéfini, même pas suggéré, laissé à l’imagination du regardeur. Ce seront peut-être des fantômes à moins que ce ne soit le retour spéculaire de l’image du spectateur laissé à ses propres contradictions et invité au passage à l’action.
Marine Vu alimente ainsi une réflexion sur l’essence même de la peinture, dégagée des règles de la perspective, des poncifs de la figuration mais aussi des canons de l’abstraction. Qu’en est-il d’une image qui n’en est pas une, apparaissant sur un fond dont elle ne se détache pas et dont la perception se forme et se déforme selon l’éclairage, l’angle de vue et l’orientation du support ? Ces formes difficiles à percevoir marquent un mouvement que les mots du commentateur ne peuvent que fixer dans un arbitraire désespérément réducteur. Marine Vu met en évidence les complexités et les ambivalences de toute figuration. Elle fait dialoguer dit et non-dit, intime et public, réel et virtuel, présence et absence… Elle souligne la fragilité de toute représentation, la dualité de l’image et sa plasticité aux regards que nous lui portons. |
 | La peinture de Catherine Wolff est directe et dure. Elle n’emploie pas de voie détournée pour asséner ses messages, comme autant de coups de poing ou de gifles à la figure du spectateur. Par exemple, dans L’oiseau de mauvais augure, un couple nu, alité, découvre avec stupeur, au pied de son lit, un bambin nu affairé, échappé d’une cage à oiseau voisine dont la porte est entrebâillée. On ne saurait être plus explicite pour décrire une maternité non souhaitée…
Son trait, incisif, presque caricatural, et l’économie chromatique de sa palette, souvent réduite à des camaïeux de couleurs sourdes, évoquent la période misérabiliste de Bernard Buffet ou les œuvres de la même époque de Francis Gruber. Ses personnages, tour à tour convulsifs, honteux ou effarés, nous regardent de face, yeux dans les yeux, et nous prennent à partie dans un débat auquel on ne peut ni ne veut échapper.
Catherine Wolff se défend d’être une provocatrice. Elle se veut juste révélatrice de ce que chacun porte en lui, comme elle dit fort clairement : en grattant un peu le vernis de chacun, l’image sociale, on révèle des aspects moins brillants. C’est ce à quoi je m’adonne. Mes personnages sont nus car ils révèlent, dans leur nudité, ce qui peut se jouer dans leur intimité et dans leur interrelation à l’autre. C’est cette dimension-là qui m’intéresse et que je mets en scène tel un metteur en scène. Et pour filer la métaphore, telle une comédienne, je ne me réduis pas à mes toiles. Je me contente de poser les situations, de placer les personnages. Loin de moi l’idée de donner une réponse. Les personnages sont en suspens. C’est au regardeur de conclure avec sa propre histoire. |