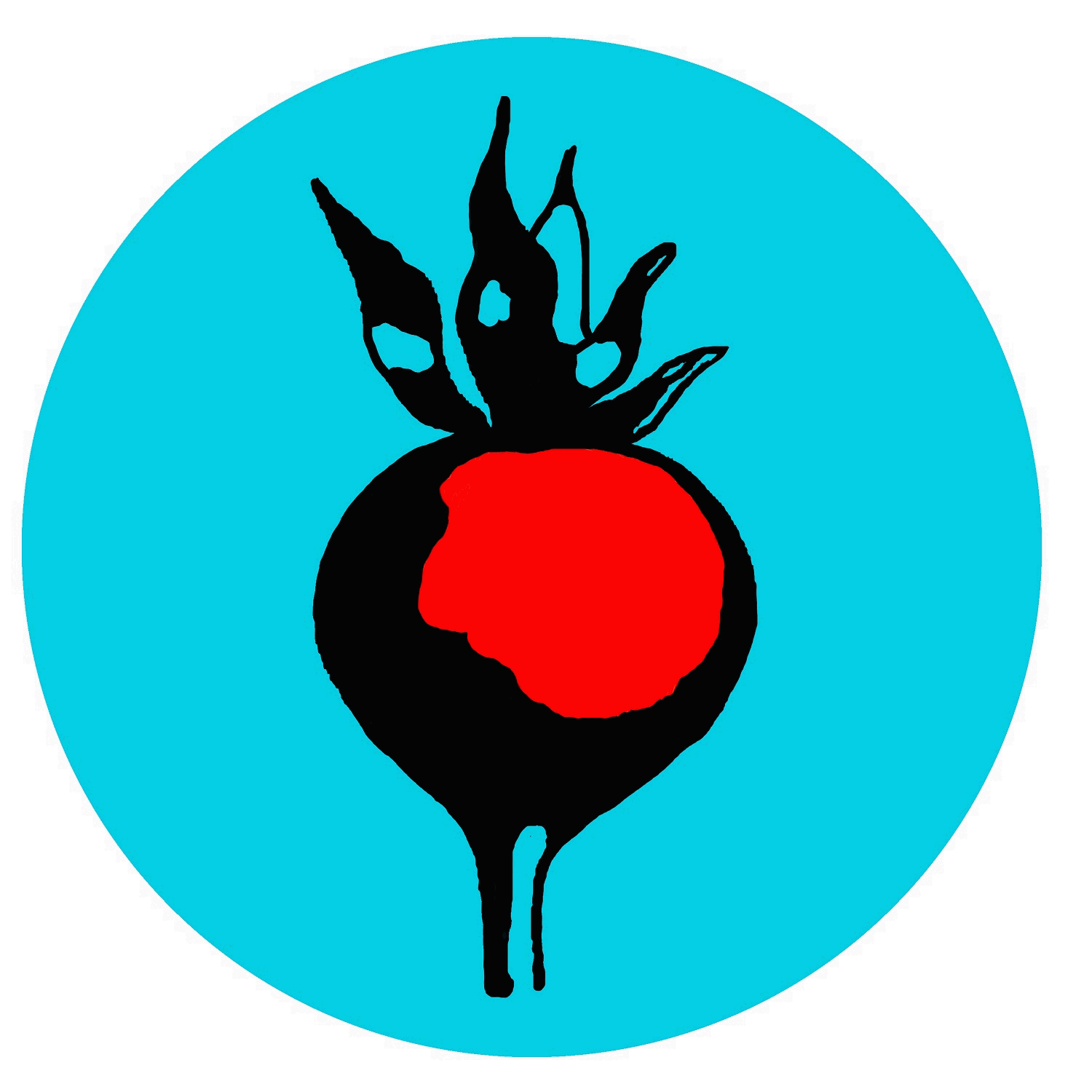|
Le poil à gratter…
|
|
Les artichauts de Chirico |
||||||||||||||||||||||||
|
|
L’Italie est comme un artichaut qu’il faut manger feuille à feuille. En 1913 et 1914, Giorgio de Chirico introduit des artichauts dans quelques-unes de ses compositions métaphysiques : Mélancolie d’un après-midi, 1913, La conquête du philosophe, 1914… La toile L’énigme du départ, dans laquelle figurent deux têtes d’artichaut et deux œufs posés sur un plan bleu en forme de billard, datée de 1916, a été peinte en 1925 et antidatée, pour des considérations très mercantiles, selon une pratique courante chez le peintre. Comment interpréter cette soudaine et brève incursion dans un répertoire d’images et de formes relativement restreint et fortement codifié ? Longtemps, l’artichaut a été considéré comme un aphrodisiaque. Au XVIIe siècle, le médecin Nicolas Abraham de La Framboisière écrivait : « Les artichaulx eschauffent le sang et incitent nature au combat amoureux de Vénus…[2] » En 1727, Jean-Joseph Mouret mettait en musique ces couplets populaires : On ne peut pas plus imaginer que Chirico fasse allusion à la notion de cœur d’artichaut désignant, dans la langue courante, une personne qui a le cœur trop tendre et donne sans discernement à autant de personnes qu’il y a de feuilles sur celui de l’artichaut. On peut aussi évacuer la référence au légume comestible, celui qui figure sur la liste de courses que Ronsard confie à son laquais : On peut aussi éliminer toute considération nationaliste chez un artiste cosmopolite qui se sentait assez peu italien et que le propos attribué à Metternich au Congrès de Vienne, en 1814, cité en exergue, ne devait pas toucher, pas plus que l’affirmation du même, dans les mêmes circonstances, que « l’Italie est une expression géographique. » Il faut donc chercher ailleurs. En fouillant les dictionnaires, on découvre une définition de l’artichaut, documentée par Sophie Jossier, dans un inventaire des termes du bâtiment : « assemblage de crocs et de pointes de fer, dont on garnit un mur ou le revers d’un fossé pour en défendre l’accès[5] » Tristan Corbière, un Breton, qui s’y connaît donc en matière d’artichauts, fait référence à cette acception du mot dans un de ses poèmes : Nous sommes en janvier 1914 et la Grande Guerre est imminente, qui va opposer, d’un côté, l’Allemagne où Chirico s’est formé à Munich et, de l’autre, l’Italie dont il est, presque par accident, citoyen, alliée de la France, son pays de résidence et d’adoption, du moins pour le moment, tant qu’il peut échapper au service militaire et à la mobilisation à Florence. C’est aussi l’époque où Chirico découvre Nietzsche et son Ecce homo dont le vocabulaire est souvent belliqueux, utilisant fréquemment le mot guerre[8] : « La tâche qui incombait aux prochaines années était prescrite aussi sévèrement que possible. Après avoir accompli la partie affirmative de cette tâche, c’était le tour de la partie négative, où il fallait dire non, agir non. Il fallait entreprendre la transmutation de toutes les valeurs qui avaient eu cours jusqu’à présent, la grande guerre, révocation du jour où la bataille serait décisive.[9] » Associés à un canon et caparaçonnés d’acier, les artichauts de Chirico font écho à ces propos. Peut-être peut-on aussi y lire une peur de la conscription qui l’attend en Italie où il est alors condamné comme déserteur… Mais ces artichauts sont aussi des armes offensives contre tous les conformismes sclérosants. La présentation d’artichauts dans une configuration agressive a eu une descendance picturale avérée. Alors que, jusqu’au XIXe siècle, ces légumes, peu présents dans les natures mortes, étaient figurés tout en rondeur, comme dans la Nature morte aux artichauts, 1774, de Luis Egidio Melendez, au XXe siècle ils se hérissent et deviennent menaçant, comme en témoignent, par exemple, La Composition aux artichauts, 1945, de Pierre Tal-Coat ou Les artichauts, 1964, de Jean Hélion… Passer, en quelques siècles, d’un aphrodisiaque à une arme offensive ou défensive… Triste évolution de notre Société… Louis Doucet, novembre 2020
[1] Propos qui aurait été tenu dans les marges du Congrès de Vienne, en 1816.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Voleur d’images |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Pour le peintre, voir, c’est s’approprier. Dans un de ses récits de voyage,[3] Eugène Fromentin souligne la proximité, dans la langue arabe, des mots الرسام et اللص désignant respectivement un peintre et un voleur. Même si aucun rapport étymologique ne lie ces deux mots dont les prononciations sont voisines, le propos ne manque pas de pertinence. Lors d’un de ses séjours en Algérie, le littérateur et peintre orientaliste attribue à cette fausse parenté lexicale la réticence de tous ses modèles potentiels, hommes, femmes ou enfants, à poser pour être peints. Pour lui, le fait de reproduire un visage ou une silhouette serait perçu comme un acte de vol par leurs propriétaires légitimes. On sait que, dans les premiers temps de la photographie, des anthropologues ont constaté que, dans certaines populations extra-européennes, prendre une photographie d’une personne c’était voler son âme…[4] Que diraient alors ces mêmes sujets de la technique des hologrammes, à laquelle certains de nos tribuns populistes, entre autres, commencent à recourir ? La notion de vol de l’âme ou du reflet est aussi présente dans la littérature fantastique. Que l’on pense, par exemple, aux Contes d’Hoffmann d’Offenbach et à l’acte dans lequel la belle Giulietta ravit successivement l’ombre de Schlemil et le reflet d’Hoffmann… Et elle n’est pas peintre… Mais revenons à la peinture. Le peintre vide-t-il le modèle de son essence en se l’appropriant, ce qui est le point de vue de Lenz, ou lui donne-t-il une âme, comme le prétend Chamfort ? Les points de vue sont contradictoires et anciens. La légende de la fille du potier Butadès transformant le profil de son amant partant à la guerre en effigie de terre cuite est un premier exemple d’un transfert d’essence du vivant vers l’image. Dans la lecture qu’en donne Jean-Baptiste Regnault dans Dibutade ou l’Origine de la peinture, 1786, toile conservée au château de Versailles, la jeune fille tourne ostensiblement le dos à son modèle et semble porter toute son attention et son affection vers le dessin qu’elle est en train de réaliser. Lequel, du fait des vicissitudes de la guerre, restera la seule trace visible du bien-aimé… C’est le cas de toutes ces miniatures et de ces médaillons, conservés, portés et consultés avec tendresse, qui servent de substituts à l’être disparu ou éloigné… Au même titre qu’une boucle de cheveux… En 1999, Martin Bruneau a repris ce mythe fondateur de la peinture dans une série de portraits, intitulée La fable de Butadès, dont les visages sont indiscernables et les œuvres seulement désignées par la couleur uniforme de leur fond. Ici, l’image a bel et bien été irrémédiablement volée par le peintre… Au profit de qui ? La question reste ouverte… Xavier Salmon n’hésite pas, en 2004, à donner pour titre à son ouvrage sur le grand pastelliste : Maurice Quentin de La Tour – Le voleur d’âmes. Et, à l’opposé, André Lhote d’ironiser sur ces peintres amateurs qui passent leur temps à « […] tapoter du pinceau sur une toile tendue comme un piège à images. »[5] Cette notion de piège à images est devenu un poncif, une formule creuse, chez des journalistes ou critiques en mal d’inspiration pour présenter les travaux de barbouilleurs médiocres ou de peintres de talent dont ils n’arrivent pas à pénétrer l’univers. Peut-être faut-il voir dans ces points de vue contradictoires, du moins dans le domaine de la peinture de portrait, l’éternelle dualité entre l’être et le paraître. Des modèles qui veulent paraître, tels qu’ils figurent, par exemple, dans les portraits d’apparat, comme celui de Louis XIV en costume de sacre peint par Rigaud en 1701, le peintre ne pourra pas voler l’image pour la fixer sur la toile. Tout au plus matérialisera-t-il l’idée que le modèle, qui se pose en acteur d’un rôle qu’il veut assumer, veut que l’on se fasse de lui. En revanche, quand le modèle souhaite non pas paraître mais être, comme dans le Portait de Monsieur Bertin, 1832, d’Ingres, la figure crève la toile et se substitue à son modèle pour nous interpeller. Dans ce dernier cas, le peintre est effectivement coupable ou complice d’un vol d’image, voire d’âme… De fait, dans la mémoire collective, Monsieur Bertin, c’est le tableau d’Ingres… Magritte, dans La condition humaine, 1933, représente une toile posée sur un chevalet devant une fenêtre, encadrée de deux tentures, donnant sur un paysage. Ce qui figure sur la toile intégrée dans la peinture est un fragment du paysage général et serait indiscernable si ce n’étaient le piètement du trépied du chevalet et la fine bordure blanche du châssis. Le peintre a donc volé une partie du paysage pour la fixer sur une toile qui figure dans une autre toile représentant un paysage, lui aussi volé ou emprunté à un univers fictif ou réel, déréalisé par la peinture. Dans cet exercice de mise en abîme, Magritte masque ainsi un larcin par un autre, tout en mettant en cause la réalité de la perception, esquissant ainsi un plaidoyer en vue de son acquittement du délit de vol d’image. Ceci étant dit, on ne peut s’empêcher de vouloir savoir ce qu’il y a derrière cette image intrigante qui s’incruste dans une autre… Même si l’on connaît d’avance la réponse, puisqu’il ne s’agit, après tout, que de peinture… On y lit une allégorie de la condition humaine en ce que le spectateur, être conscient, se fait d’un monde qu’il pourrait habiter – mais qui n’est, après tout, lui aussi, qu’une fiction – une représentation qui se confond avec l’image qu’il s’en fait. Cette fois-ci, c’est le spectateur qui se fait complice d’une appropriation ou d’un détournement d’une réalité dont l’existence est d’ailleurs douteuse. Les pop-artists étasuniens des années 1960, tel Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ou Tom Wesselmann se sont approprié des images issues du monde de la publicité, de la presse, de la bande dessinée…, pas du tout ou à peine modifiées, pour en faire les composantes essentielles, voire uniques, de leurs compositions. Ce qui caractérise la plupart des artistes de ce mouvement, c’est que les images qu’ils volent sont, en général, vidées de tout poids ou contenu psychologique, de tout sentiment. Elles ont même été choisies pour cette raison, comme pièces à conviction d’un procès instruit contre la société de consommation qui viderait tout ce qu’elle touche de sens et d’émotion. Si vol il y a, il est sans grand profit pour le voleur. Et puis, sur le plan moral, ces images ont déjà été volées au grand public par des entreprises de peu de scrupules… C’est du moins ce que prétendent ces artistes… Voler un voleur, ce n’est peut-être pas un délit… Plus tard, certains d’entre eux, tel Lichtenstein, dans les années 1970, se sont même emparés de chefs-d’œuvre de l’art du XXe siècle comme matière première pour leurs propres œuvres. Vol, citation ou hommage ? La question reste ouverte… Dans une œuvre comme Stepping out, 1978, il ne s’agit évidemment pas de plagiat ni de contrefaçon de Fernand Léger et/ou de Pablo Picasso. Alors variation, relecture, détournement ? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet[6] et ne souhaite pas entrer, ici, dans un nouvel exposé des frontières poreuses entre ces différents procédés. Notons cependant, que certains ayants-droits, comme ceux d’Hergé,[7] poursuivent systématiquement en justice les auteurs de tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à un emprunt – qualifié de vol – au maître. La sanction peut aller jusqu’à six mois de prison ferme pour avoir dessiné Tintin dans une composition… Voilà qui peut faire réfléchir les voleurs, admirateurs, plagiaires, détourneurs… potentiels ! Dans certaines de ses œuvres, Gerhard Richter exploite aussi des images préexistantes. Elles peuvent être du domaine du privé, comme dans Onkel Rudi, 1965, exploitant une photographie d’un album de famille, ou dans Matrosen, 1966, partant d’une photographie anonyme publiée dans un magazine. Dans ces deux cas, comme dans beaucoup d’autres chez Richter, les références à la période noire du nazisme sont prégnantes. Dans d’autres séries, par exemple dans celle dont est tirée la peinture Gegenüberstellung 2, 1988, Richter fait référence à l’histoire récente et part d’images dont l’actualité est encore très marquante au moment où l’œuvre est peinte. Dans le cas présent, il extrait une portion d’une photographie de Gudrun Ensslin, terroriste allemande de la Bande à Baader, lors d’une séance d’identification policière (Gegenüberstellung). L’opération de recadrage de l’image initiale contribue à dépersonnaliser le sujet et à en atténuer le contexte violent. On constate donc, chez Richter, un double mouvement : universaliser des images empruntées au cercle privé et banaliser des images prélevées dans la sphère publique. Vols ou emprunts ? Le cas de Michelangelo Pistoletto est plus emblématique du peintre-voleur. Dans ses peintures sur des surfaces réfléchissantes – miroir ou acier poli – se superposent une image peinte par le plasticien et les reflets mouvants des spectateurs face à l’œuvre. Dans son Autoritratto, 1962, le peintre se soucie peu de ce qui se passe dans la salle d’exposition car il s’est figuré de dos, déniant ainsi d’emblée toute possibilité de communication avec le regardeur. Lequel est pourtant invité à pénétrer l’œuvre, à l’échelle 1/1, accrochée près du sol, de plain-pied avec lui. Ces Tableaux Miroirs, quand ils sont présentés à grande échelle, font subsister un doute sur ce qui est peint et ce qui est réfléchi. Seul le mouvement des spectateurs permet de discerner ce qui est figé de ce qui est piégé… mais vite relâché… Vol de courte durée, suivi d’une restitution sans négociation… On ne peut s’empêcher de penser à Hoffmann séduit par Giulietta… Dans des séries plus récentes, en forme de performance, comme Twenty Two Less Two, 2009, Pistoletto, armé d’une masse, brise les miroirs dans lesquels se reflète une foule hébétée… Peut-être une façon de se débarrasser de cette étiquette de voleur d’images… Dans les dialogues écrits pour le film Le Guignolo de Georges Lautner, 1980, Michel Audiard fait dire à un des protagonistes de l’action : « Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. » Si le peintre est voleur et ses tableaux le résultat de larcins, le propos devient inexact. Tout au plus pourrait-on qualifier le galeriste de receleur… Receleur de biens immatériels, cas non prévu par le code pénal, que je sache… Louis Doucet, octobre 2020
[1] In Schweigeminute, 2008.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Quelques acquisitions récentes |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Espace d’art Chaillioux Fresnes 94
du 13 mars au 30 avril 2021 Regards de femmes
du 22 mai au 17 juillet 2021 La photographie et ses dérives II
|
|
| ||||||||||||||||||||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2021
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre
–
Ne plus recevoir la lettre