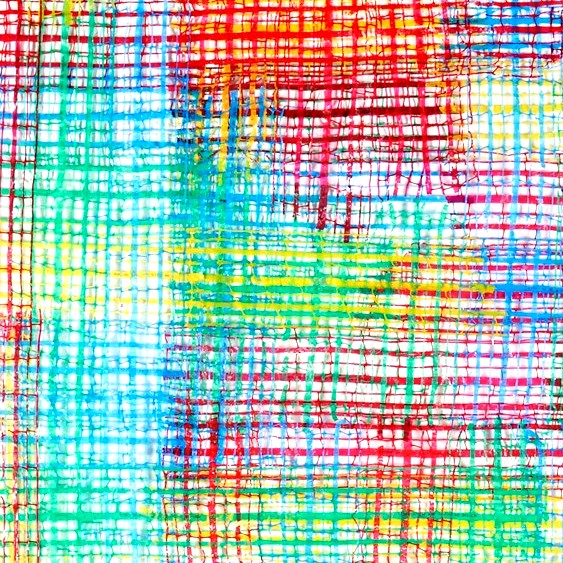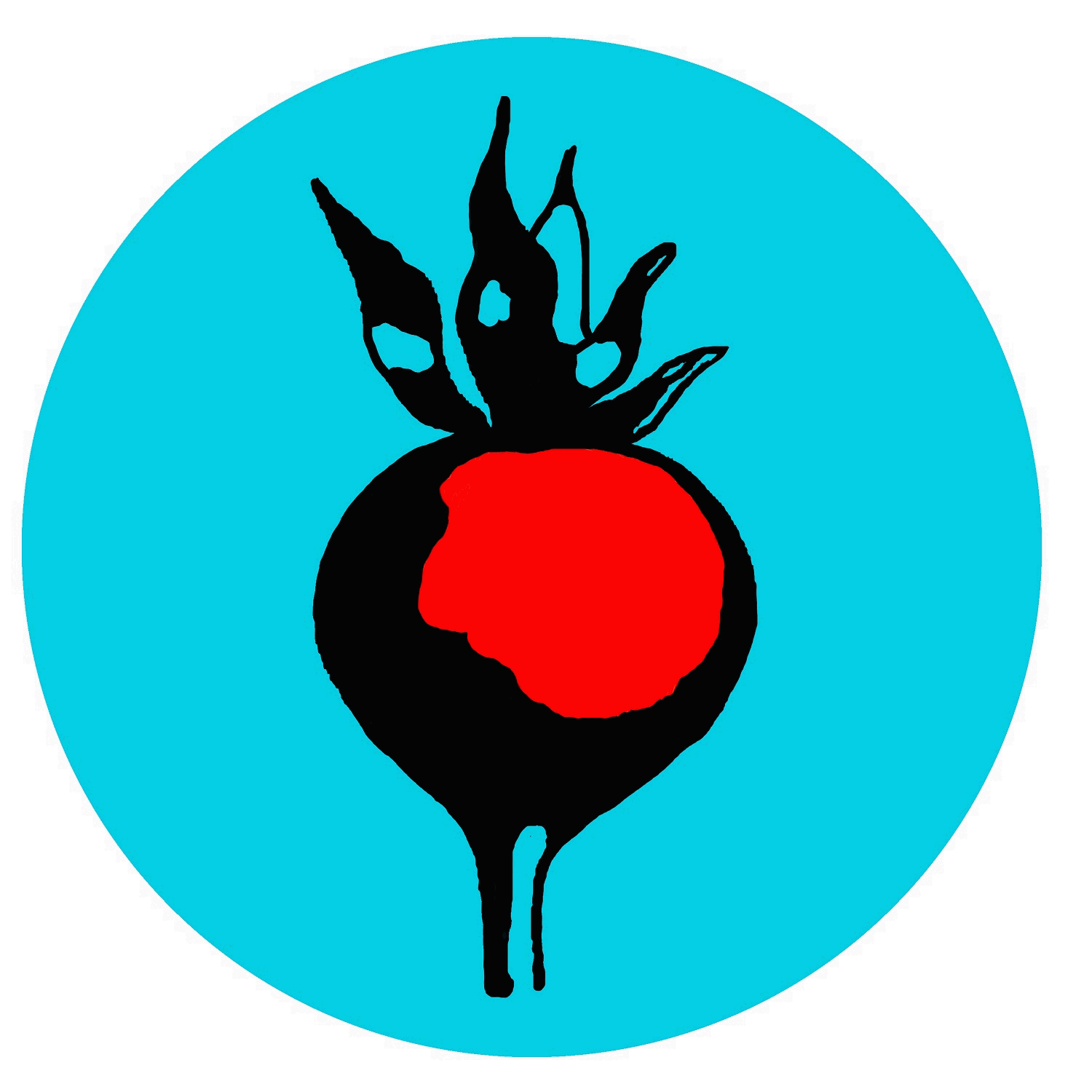|
Le poil à gratter…
|
|
Les indégivrables |
le suffrage universel n’a jamais déterminé la vérité de l’esprit ! Tous les matins, vers 9h, quand je reçois, dans ma boîte de courrier électronique, le brief du journal Le Monde, je commence, avant toute chose, par consulter, en milieu de page, le dessin de Xavier Gorce de sa série des Indégivrables. Chaque jour, ses pingouins mettent en scène, avec un remarquable à-propos, dans un humour souvent mêlée de cruauté, l’actualité de la veille ou les névroses durables de notre société. Et si cruauté il y a, c’est celle de la réalité que l’on se refuse à voir en face… Au mois d’août, le dessinateur, comme beaucoup d’autres, prend des vacances. À la place du dessin quotidien apparaît un bandeau annonçant son retour, à la rentrée, en septembre. Me sentant quelque peu sevré, pendant quatre longues semaines, je me console en consultant, sur Internet, les dessins des années et mois passés, notamment ceux, finalement assez peu nombreux, qui abordent la question de l’art contemporain et de sa réception par le grand public. Leur relative rareté – une trentaine en quinze ans – témoigne, s’il le fallait encore, du peu d’intérêt de la presse et du grand public pour la création plastique. Ceci étant constaté, il n’en reste pas moins que les quelques dessins qui y sont consacrés posent avec pertinence et acuité un certain nombre de problèmes liés au statut de la création plastique contemporaine dans notre société. Le premier pose une question fondamentale et trop souvent clivante, celle de l’identification de l’œuvre d’art véritable.
Plus prosaïquement, et plus récemment, la presse se fait, de temps à autre, l’écho d’œuvres plastiques – notamment des installations – détruites par des agents de nettoyage qui pensaient bien faire en les traitant comme des déchets. Ces informations, dont un public déculturé est friand, nourrissent l’idée, encouragée par les populistes de tous crins, que la création plastique contemporaine n’est qu’une vaste supercherie. Elle incite aussi à des actes moins innocents : la destruction volontaire d’œuvres qui n’ont pas l’heur de plaire à des extrémistes s’instituant en censeurs du bon goût. Je me suis déjà exprimé, à plusieurs reprises, sur le caractère très inquiétant de telles manifestations qui traduisent la montée d’une forme de totalitarisme intellectuel dont la première partie du XXe siècle a fourni des modèles mortifères… Ce n’est qu’en 1981 que Danto nous livre, dans un bref essai[2] d’une rare densité, sa conclusion de plusieurs années de réflexion sur ce sujet. En résumant à l’extrême son texte – toujours pas traduit en français, à ma connaissance –, pour Danto, une œuvre d’art ne l’est qu’à deux conditions nécessaires et suffisantes cumulatives 1) être à propos de quelque chose (to be about something) et 2) donner corps à sa signification (to embody its meaning). La représentation plastique serait donc un signe[3], au sens saussurien de ce mot, et non une simple image. Elle résulterait d’un geste intentionnel projetant une idée ou un concept dans le concret. Avant lui, Pierre Bourdieu avait déjà esquissé une différence de même nature en distinguant, dans une réflexion sur le travail de Manet, le modus operandi et l’opus operatum.[4] Ainsi, pour l’un comme pour l’autre, le statut d’œuvre d’art ne relève pas de critères perceptifs ou affectifs, mais découle de la signification que le couple créateur-spectateur veut bien lui attacher. Pour le regardeur, tout comme pour le lecteur d’un poème, cette signification peut changer au fil du temps ou en fonction de la découverte de détails ou d’aspects nouveaux qui modifient son interprétation. Ainsi, l’œuvre d’art est donc, par essence, distincte d’un objet du monde, même si elle en est apparemment indiscernable. Un rien, un titre, une mise en contexte, un détail, un commentaire suffisent pour en changer la valeur esthétique, la signification plastique. Ce même dessin de Xavier Gorce moque les prérogatives exorbitantes que le critique d’art s’arroge, tout comme un autre dessin ridiculise le galimatias explicatif auquel il a recours pour défendre certaines œuvres.
En 2015, dans un texte intitulé Pour une critique d’art subjective[8], j’évoquais les trois points de vue selon lesquels le critique peut se positionner : il peut être subjectif (du point de vue du spectateur), objectif (de celui de l’œuvre) ou démiurgique (se substituant à l’artiste). Je citais Walter Benjamin : « L’art du critique in nuce : forger des formules sans trahir les idées. Les formules d’une critique insuffisante bradent la pensée au profit de la mode. »[9] Et aussi Serge Fauchereau : « En France, on reste trop dirigiste ; on suggère fortement une certaine compréhension, on a tendance – heureusement pas toujours – à indiquer au public comment il faudrait penser. À l’étranger, c’est très différent : on fournit les informations au public et libre à lui de se forger son opinion, de manière plus objective. C’est une question de confiance. Exempt d’interprétation trop étroite, le musée remplit alors sa mission, laissant aux essayistes et aux historiens leur rôle d’analyser et de formuler des hypothèses. »[10] Même si le mot subjectif a été dévoyé de son sens initial – du point de vue du sujet, donc, en l’occurrence, du regardeur – et a aujourd’hui une connotation péjorative, je plaidais et continue à plaider pour une critique subjective. Celle-là même, systématique et cultivée, que Roland Barthes appelle de ses vœux dans le domaine littéraire.[11] Ne pas se substituer à l’artiste, ne pas être redondant en décrivant froidement l’œuvre, ne pas indiquer au spectateur comment il doit penser, mais mettre sa propre subjectivité au service des autres, être un passeur, un facilitateur, un catalyseur d’idées et de sensibilité. En un mot, être un médiateur entre l’œuvre et son public, paraphrasant un propos de Hegel : « c’est le travail de médiation qui éveille la conscience des autres. »[12] C’est pourquoi j’écrivais, en 2015 : « Le critique doit s’attacher à expliquer, sans tomber dans une description stérile et redondante, ne pas se substituer à l’artiste ni le trahir, ouvrir les portes d’interprétations multiples, sans en refermer aucune, suggérer l’existence d’autres voies d’accès, sans trop les baliser, inciter le lecteur à les emprunter, à en découvrir d’autres et à se forger sa propre interprétation de l’objet… »[13] C’est pourquoi j’ai toujours apprécié le recours intelligent au je dans les critiques de feu Bernard Point. Les deux dessins qui suivent illustrent cette braderie de la pensée au profit de la mode qu’évoque Walter Benjamin.
Ceci ne serait, finalement, pas trop grave s’il n’y avait, de façon concomitante, la montée de la dictature du politiquement correct, notion accommodable à toutes les sauces pour servir des intérêts partisans et dont tous les régimes totalitaires des XXe et XXIe siècles ont largement fait usage de façon autoritaire. Certes, aujourd’hui, en Occident, il ne s’impose pas du haut, mais plutôt par une forme de consensus mou nourri par la paresse, la lâcheté, le repli sur soi-même, l’hypertrophie du je,[14] le manque de curiosité et la déculturation, tous caractéristiques de l’évolution de nos sociétés occidentales. Isabelle Barbéris analyse fort bien ce phénomène : « Le politiquement correct progresse par paralysie douce et glacis afin de déminer la situation de communication de toute offense potentielle. Il relève d’un effort de dé-potentialisation du langage. »[15] Une des graves conséquences de ce politiquement correct est le retour à une forme insidieuse de censure au nom du vive-ensemble, du ne-pas-choquer ou du ne-pas-faire-de-vagues. Deux des dessins de Xavier Gorce l’évoquent fort bien.
La bien-pensance et le politiquement correct peuvent affecter des formes de contestation, pourvu qu’elles restent sans conséquence. C’est ainsi que la contestation du système et la transgression – pourvu qu’elles n’affectent pas le consensus mou du politiquement correct quotidien – sont devenues une nouvelle forme d’académisme. Le dessin suivant l’illustre bien.
Cette dernière vignette, aborde aussi un autre sujet que Xavier Gorce développe dans d’autres images : celle de la folie spéculative du marché de l’art.
Cette situation a toujours existé et l’institution, depuis plus de trois siècles, a toujours fait fausse route dans ses politiques de promotion et d’acquisition d’art de leur temps. Faut-il rappeler, par exemple le mépris dans lequel les œuvres de Chardin étaient tenues en leur temps, les tergiversations autour du legs Caillebotte[16], le refus de préempter Les Demoiselles d’Avignon de Picasso après le décès de Jacques Doucet, l’entrée plus que tardive, en 1974, de la première œuvre de Mondrian dans les collections nationales alors que l’artiste a vécu et construit sa notoriété à Paris de 1912 à 1914, puis de 1917 à 1938… Et bien d’autres encore… Ce sont les legs ou dations de la part de collectionneurs ou d’ayants-droit d’artistes décédés qui ont enrichi les collections visibles de nos musées, alors que les achats officiels s’entassent dans les réserves. On constate, par ailleurs, une évolution significative depuis une cinquantaine d’années : l’alignement des institutions et du marché, sans que l’on puisse d’ailleurs déterminer qui a fait un pas vers l’autre. Raymonde Moulin, grande sociologue et historienne du marché de l’art, qui vient de nous quitter, constatait, en 2003, parlant des années 1960-1970 : « Pour l’essentiel, l’art qu’on appelait à ce moment-là l’art de mouvement ou l’art vivant, qui était souvent l’art abstrait [...], cet art-là dépendait essentiellement du marché parce qu’il n’était pas compris, ni acheté par les institutions. […] Tandis que 25 ans après, pour cet art-là, qui s’appelle maintenant l’art contemporain [...], il y avait le soutien conjugué des institutions et du marché. »[17] Ceci a pour conséquence une forme de normalisation qui marginalise toute production qui ne répond pas aux critères communs des unes et de l’autre et, par conséquent, hypothèque d’autant la possibilité d’enrichissement des collections futures de nos musées. Il ne faut désormais plus compter que sur les petits collectionneurs, ceux dont les moyens sont trop faibles pour se livrer à la spéculation et/ou qui collectionnent par intérêt et goût pour les œuvres plutôt que par snobisme ou par conformisme. La plupart des plasticiens sont les victimes collatérales de cet état de fait. Les deux dessins suivants le mettent en scène.
Je demeure convaincu que c’est par l’éducation aux arts, et plus particulièrement aux arts plastiques, que nous pourrons recouvrer cette liberté si gravement menacée. Et espérons, d’ici là, que les plasticiens qui y croient encore – j’en connais un bon nombre – auront la saine réaction du pingouin de Xavier Gorce qui refuse de s’arrêter et veut encore aller de l’avant…
Louis Doucet, août 2019
[1] In Les chapelles littéraires modernes, 1929.
|
||||||||||
|
Quelques acquisitions récentes |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
À ne pas rater... |
|||||||||||
|
|
Espace d’art Chaillioux Fresnes 94
du 18 janvier au 29 février 2020 Animalité
du 14 mars au 30 avril 2020 Choses dites
du 16 mai au 18 juillet 2020 Urbanité
|
||||||||||
|
|
Nicolas Cluzel – Viande ! Crise ! & Playmobil
|
||||||||||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2020
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre
–
Ne plus recevoir la lettre